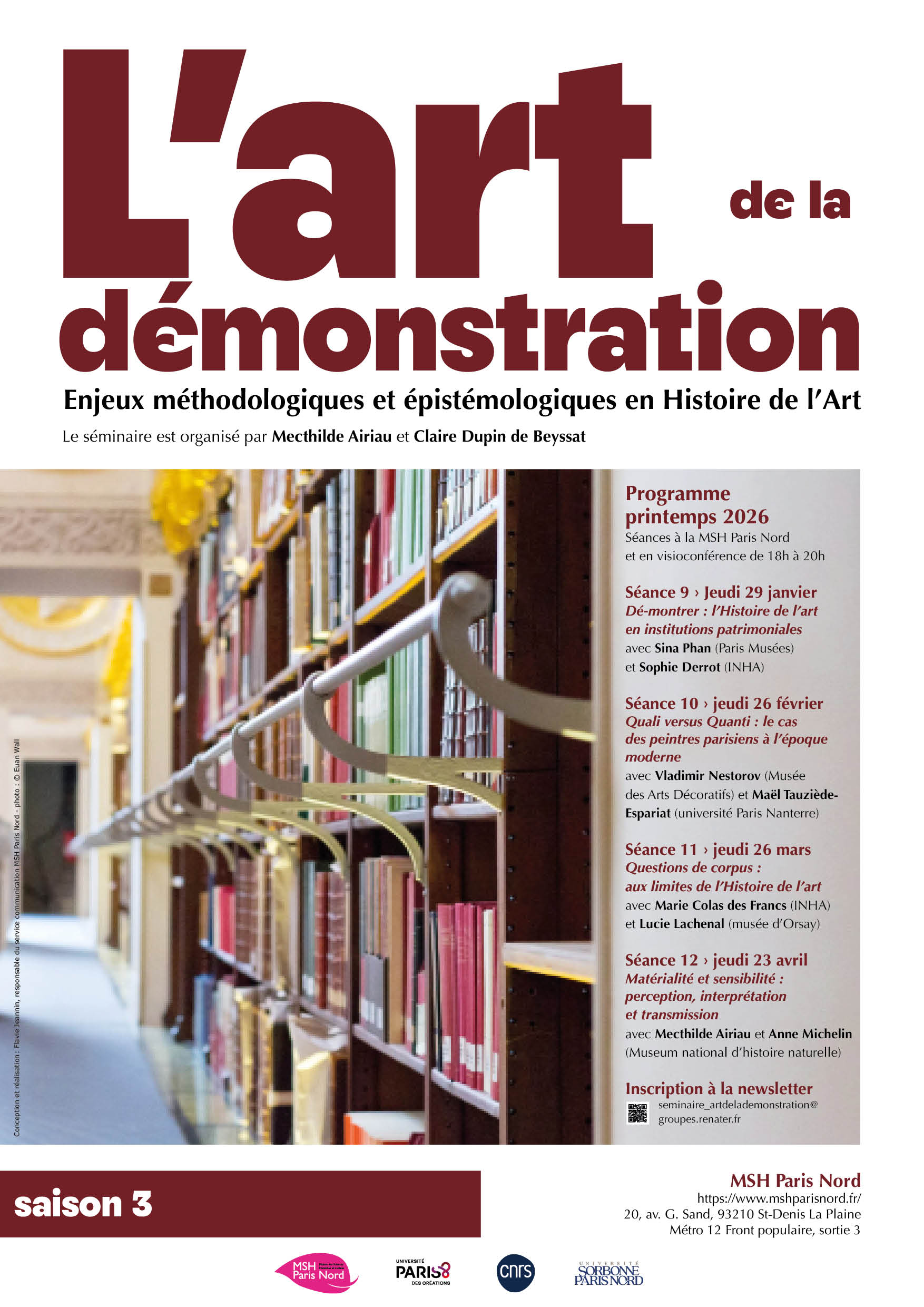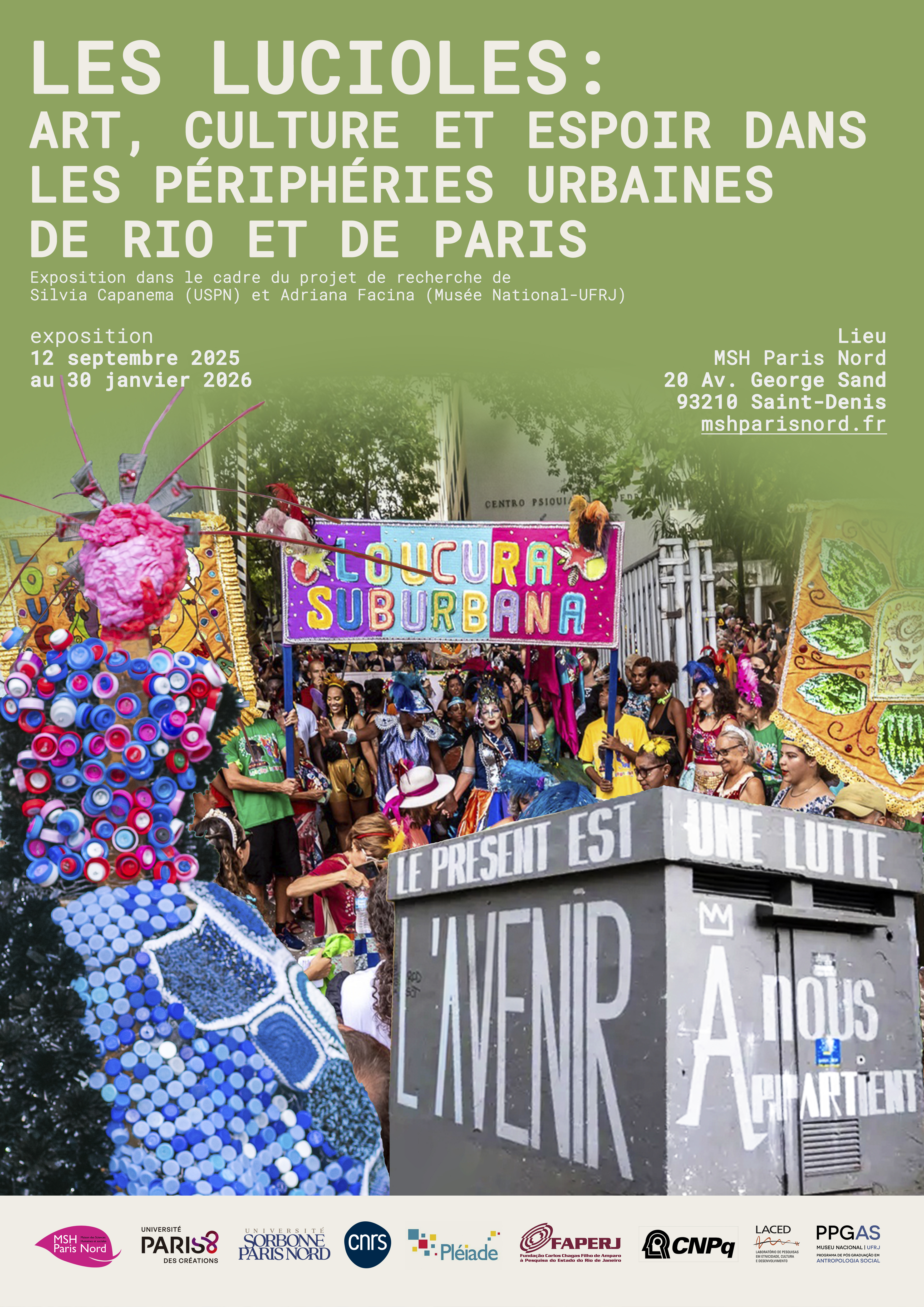Séminaire | Art, culture et création dans la fabrique des territoires
24 mars à 17:00 - 19:00
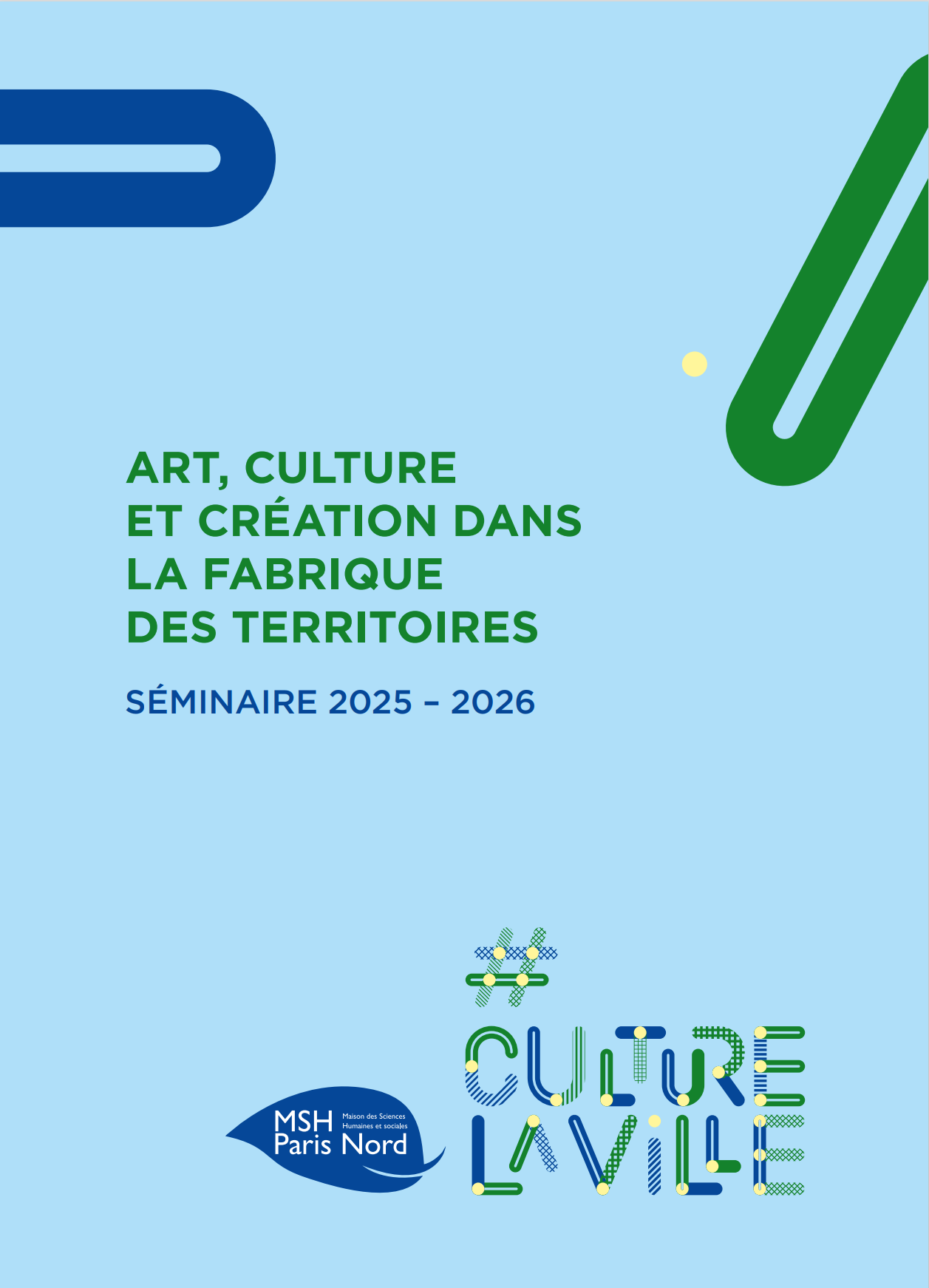
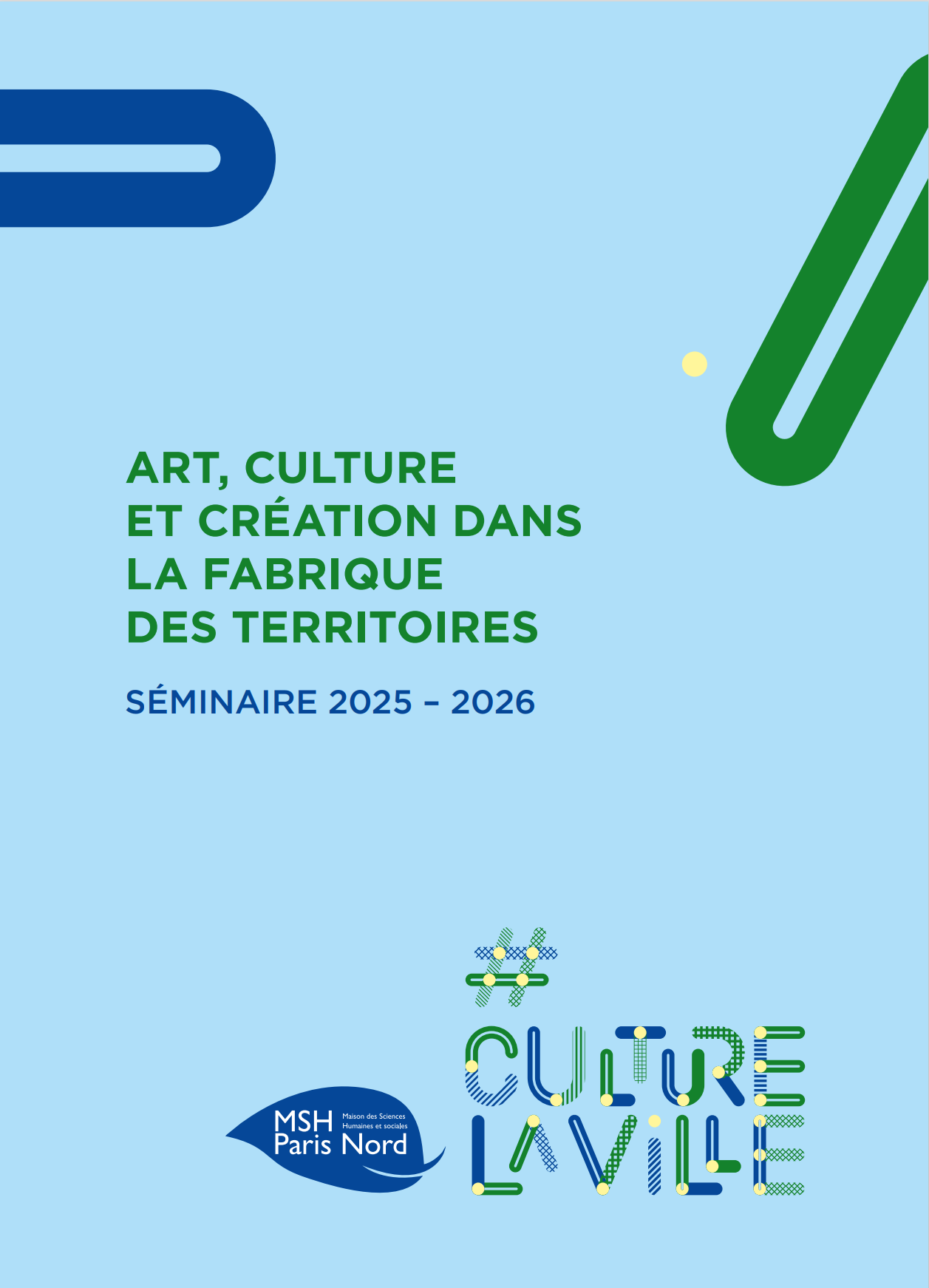 La science, l’art, la culture, le patrimoine, sont des marqueurs incontestables du territoire de Plaine Commune au sein duquel la Maison des Sciences Humaines et sociales Paris Nord compte comme actrice et institution de savoir partagé.
La science, l’art, la culture, le patrimoine, sont des marqueurs incontestables du territoire de Plaine Commune au sein duquel la Maison des Sciences Humaines et sociales Paris Nord compte comme actrice et institution de savoir partagé.
La MSH Paris Nord, avec ses 2 axes de recherche Penser la ville contemporaine et Arts, industries de la culture, création constitue un lieu de production de savoir et de réseau sur le territoire.
Pour la cinquième année consécutive, la MSH Paris Nord et la direction Stratégie culturelle, patrimoine et tourisme de Plaine Commune collaborent pour la publication d’un appel à projets de recherche commun Fabriquer la ville avec l’art et la culture ?, et la programmation d’un cycle de séminaires réunissant chercheur·es, acteurs et actrices du territoire pour réfléchir à la manière dont les projets culturels et les projets urbains sont dorénavant étroitement liés, ici et ailleurs.
Les séminaires veulent interroger cette production du territoire urbain par la culture et, en retour, étudier comment les enjeux territoriaux jouent sur les projets culturels. Ils visent également à examiner les discours, les paradigmes et les récits engagés.
Le cycle est animé par Emmanuelle Lallement, professeure d’anthropologie à l’université Paris 8 et responsable de l’axe 4 de la MSH Paris Nord et par Nicolas Maïsetti, maitre de conférences en sociologie à l’université Paris 8.
Suivez les informations relatives au séminaire en vous inscrivant à la liste de diffusion via ce lien.
Dans la mesure du possible les séminaires sont privilégiés en présentiel. Cependant, chaque séance pourra être suivie en visioconférence à partir du lien suivant :
https://univ-paris8.zoom.us/j/98703814925?pwd=Vis3RFNTRSttZDZWTU1SMnZOZlBqQT09
ID : 987 0381 4925
Code secret : 829313
Programme
Séance 1 : Quel quartier culturel après la ville créative ?
Mardi 4 novembre 2025, de 17h à 19h
Salle panoramique à la MSH Paris Nord
Sous la plume de l’urbaniste-consultant Richard Florida au début des années 2000, la notion de « ville créative » a été autant mobilisée dans le champ de l’action publique que discutée dans celui des études urbaines. Pensée comme « alternative à la ville industrielle » (Vivant, 2009), elle encourageait les élites des grandes villes à favoriser l’installation des populations des 3 T, c’est-à-dire combinant « Talents, Tolérance et Technologies ». La ville créative s’est ainsi déclinée en « classe créative » (au prix d’acrobaties théoriques et empiriques) puis en « quartiers créatifs » ou culturels (Michel, 2022). Les critiques de cette approche n’ont pas manqué pointant l’instrumentalisation économique de la culture et voyant dans cette dénomination une intention marketing lovée dans les orientations néo-libérales de la fabrique urbaine. Aujourd’hui, au moins dans les discours, ce paradigme semble refluer, sans qu’il n’ait été complètement remplacée dans la palette des urbanistes ou dans le débat intellectuel. Surtout, qu’en est-il de ces quartiers culturels et créatifs implantés ici et là depuis un quart de siècle : comment survivent-ils au concept et aux politiques qui les ont vus naître ? Au prix de quelles transformations ? Leur passé a-t-il encore un avenir ?
Intervenant·es
- Un·e représentant·e du quartier des spectacles de Montréal
- Basile Michel, maître de conférences en géographie à l’université de Cergy Paris
- Marina Rotolo, maîtresse de conférences en sociologie urbaine, ENSA Paris-Belleville
Séance 2 : Les agences d’urbanisme sont-elles des acteurs culturels de territoire (qui s’ignorent) ?
Mardi 2 décembre 2025, de 17h à 19h
À Plaine Commune
À l’occasion d’une rencontre de la Plateforme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines (POPSU) en mai 2025, le directeur de l’agence d’urbanisme de Clermont Massif central, Stéphane Cordodès, posait la question du rôle des agences d’urbanisme comme « acteurs culturels ». Il appelait les professionnel·les de l’urbanisme à dépasser l’horizon technique de leurs pratiques et les artistes à revendiquer une place à part entière comme producteurs de la ville. Cette seconde séance du cycle de séminaire entend donc prendre au sérieux ce parti pris consistant à considérer les agences d’urbanisme (et au-delà, les experts « techniques » de la fabrique urbaine) comme n’étant pas extérieurs à la culture ; et, réciproquement, les artistes et les opérateurs culturels, comme protagonistes de la production des villes. C’est au fond la question de « l’urbanisme culturel » qui est posée ici, et réciproquement, l’art et la culture comme objet urbain et urbanistique. De quoi ces changements sont-ils le nom ?
Intervenant·es
- Stéphane Cordobès, directeur général de l’agence d’urbanisme de Clermont Massif Central
- Agathe Ottavi, doctorante en sciences du langage, université Rennes 2, L’urbanisme culturel : tentative de description d’une pratique hybride au croisement de l’art, des sciences sociales et de l’urbanisme
Animé par Emmanuelle Lallement, professeure d’anthropologie à l’université Paris 8 et responsable de l’axe 4 de la MSH Paris Nord et
par Nicolas Maisetti, maître de conférences en sociologie à l’université Paris 8.
Séance 3 : Citoyenneté, art et culture en ville
Mardi 3 février 2026, de 17h à 19h
Salle panoramique à la MSH Paris Nord
L’art est de plus en plus convoqué pour des finalités relevant de la citoyenneté. Déjà, dès la première moitié du XXe siècle, l’art était défendu par certains pouvoirs publics nationaux et locaux comme un instrument de démocratisation. Aujourd’hui, art et culture sont présentés comme des leviers d’action pour prévenir et lutter contre l’exclusion, favoriser le lien social, œuvrer en faveur d’une éducation pour toutes et tous, associés à la qualité de la vie urbaine, au développement économique d’un territoire, et encore plus récemment à l’accélération de la transition écologique. Cette séance questionnera les articulations entre citoyenneté, art et culture en milieu urbain, en s’intéressant à celles et ceux qui font de la participation citoyenne un objet central de l’action culturelle (l’initiative Banlieues Capitale et son association avec une équipe de chercheur·ses de l’Université de Cergy dans le cadre du projet ECCE – Engagements dans la Cité par la Culture en Europe). La question particulière des enfants et des publics en situation de handicap pourra également être débattue tant elle éclaire les nouvelles ouvertures offertes par de nouveaux usages de la culture dans les politiques urbaines.
Intervenant·es
- Jessica Brandler, docteure en sociologie, chercheuse associée au Centre Emile Durkheim, université de Bordeaux
- Florentin Cornée, responsable de la préfiguration du programme national d’expérimentation « Culture et aménagement »
- Mélanie Fioleau, cheffe de projets culture et territoire, la Fabrique des impossibles
Séance 4 : Art et lien social : la culture dans les programmes de renouvellement urbain
Mardi 24 mars 2026, de 17h à 19h
Salle panoramique, à la MSH Paris Nord
Les séances précédentes du séminaire ont souligné les différentes manières dont les dispositifs culturels sont pensés comme outil de cohésion sociale. Cette séance propose de revenir de manière critique sur les logiques de contrôle social et de légitimation des projets qui ne sont pas absentes des liens entre art et lien social, en particulier dès lors qu’ils prennent pied dans les quartiers populaires qui font l’objet de programmes de renouvellement urbain. Comment et dans quelles conditions l’art peut être effectivement mobilisé comme vecteur de lutte contre la ségrégation socio-spatiale ? Comment dépasser la fonction instrumentale de l’art pour qu’il permette une reconnaissance pleine et entière des pratiques culturelles et des identités plurielles dans les quartiers populaires ? Comment, enfin, la notion d’empowerment dans le champ des pratiques et des politiques culturelles peut-elle prendre son sens et produire des effets tant dans les usages que dans les représentations d’espaces et de populations stigmatisé·es ?
Intervenant·es
- Christine Lelévrier professeure à l’école d’Urbanisme de Paris (Université Paris-Est-Créteil) et directrice du Laboratoire Lab’urba
- Sarah Harper, artiste et chercheuse, co-fondatrice de la compagnie Friches Théâtre Urbain
- Lucile Rimbert, chorégraphe, interprète et directrice artistique de la Compagnie LU2
Séance animée par Emmanuelle Lallement, professeure d’anthropologie à l’université Paris 8 et responsable de l’axe 4 de la MSH Paris Nord et par Nicolas Maisetti, maître de conférences en sociologie à l’université Paris 8.
Séance 5 : Les patrimoines matériels et immatériels dans la ville contemporaine
Mardi 26 mai 2026, de 17h à 19h
Salle panoramique à la MSH Paris Nord
La question de la mise en mémoire des espaces urbains et des processus de patrimonialisation de/dans la ville se trouve au cœur d’enjeux contemporains. Elle s’articule avec la question de l’urbanisation et de la transformation même des villes. Elle anime le projet scientifique de la MSH Paris Nord avec son axe 4 Penser la ville contemporaine et plus particulièrement son thème A Mémoire et territoire : représentations, narrations, patrimonialisations porté par Céline Barrère, sociologue et urbaniste, qui nous proposera dans cette séance une mise en perspective de 5 ans de projets de recherche soutenus et suivis. Les processus de patrimonialisation en milieu urbain font en effet l’objet de nombres de recherches en SHS qui, comme le développait déjà l’ouvrage La ville patrimoine. Formes, logiques, enjeux et stratégies sous la direction de C. De Saint Pierre en 2014, se trouvent en prise avec la question de la patrimonialisation dans des contextes locaux, nationaux et globalisés variés. Ici et là, sous différentes formes, se multiplient des processus de patrimonialisation, actions explicites visant à faire reconnaître un lieu comme remarquable — porteur d’une mémoire jugée digne d’être connue, conservée et transmise, et incarnant par sa forme ou son expression une singularité liée à un passé proche ou lointain —, mais aussi pratiques plus ordinaires, opérations artistiques, qui qualifient ou requalifient un espace comme emblématique d’une histoire et d’une population. Qu’il soit matériel ou immatériel, le patrimoine fait l’objet d’opérations de production qui mettent ainsi la ville, ses habitants et leur identité en débat.
Intervenant·es
- Plus d’informations à venir
Informations pratiques
- Mardi 4 novembre 2025 à 17h, à la MSH Paris Nord, salle panoramique, 4e étage
- Mardi 2 décembre 2025 à 17h, à Plaine Commune
- Mardi 3 février 2026 à 17h, à la MSH Paris Nord, salle panoramique, 4e étage
- Mardi 24 mars 2026 à 17h, à Plaine Commune
- Mardi 26 mai 2026 à 17h, à la MSH Paris Nord, salle panoramique, 4e étage
Une initiative portée par Plaine Commune et la Maison des Sciences Humaines et sociales Paris Nord.