Soirée de lancement en ligne à l’occasion de la parution de l’ouvrage Sur la trace des suspects. L’incorporation de la preuve et de l’indice à…
Catégorie : Publications
Pandémies, Des origines à la Covid 19
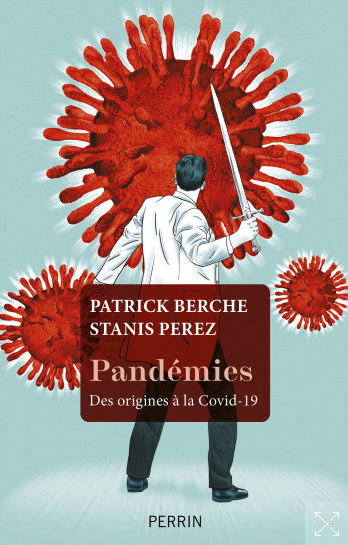
Publication de Patrick BERCHE et Stanis PEREZ
Un brillant historien et un éminent professeur s’associent pour livrer la première grande synthèse historique sur “le” sujet au cœur de l’actualité.
Comment comparer la peste de Justinien, qui se répandit comme une traînée de poudre dans tout le bassin méditerranéen dès le VIe siècle, et le sida, ce redoutable fléau que l’on ne découvrit que dans les années 1980 ? Aussi variées que soient leurs manifestations, les pathologies décrites dans cet ouvrage – choléra, syphilis, lèpre, variole… – ont un point commun : toutes sont des pandémies. Transmises par contagion, elles s’étendent en un temps record sur de vastes régions et touchent ainsi une part importante de la population mondiale. Dès lors, comment lutter contre ces ennemis invisibles qui semblent frapper au hasard ? Quelles stratégies adopter pour combattre ces maux, sans laisser la peur et la panique prendre le dessus ? Faut-il s’en remettre aux pouvoirs en place, ou bien chercher des réponses auprès des scientifiques ?
Stanis Perez, historien, coordonnateur de thème de l’axe 2 de recherche “Corps, Santé et société” de la MSH Paris Nord, est également le référent de la plateforme de recherche fin de vie.
>> présentation de la plateforme de recherche fin de vie
Date de parution : 01/04/2021
Editeur Perrin
EAN : 9782262082215
Nombre de pages : 528
Format : 154 x 240 mm
>> consulter le livre sur le site de l’éditeur
https://www.lisez.com/livre-grand-format/pandemies/9782262082215
Ego Alter
Dialogues pour l’avenir de la Terre de Jean-Hugues Barthélémy
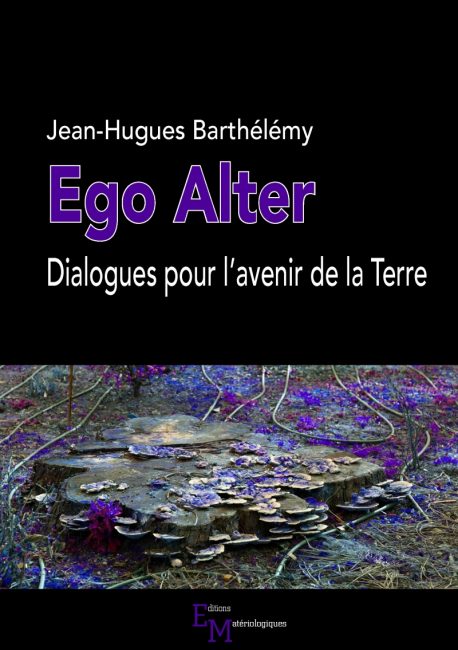
Ego Alter, notre alter ego et notre observateur non humain, dialogue ici avec une scientifique et un philosophe pour nous aider à accomplir le Grand Décentrement qui manque à notre espèce, devenue destructrice de l’équilibre biosphérique à la faveur d’une occidentalisation techno-capitaliste nommée « mondialisation ». Au fil de ces entretiens profondément novateurs, tous les thèmes majeurs de notre époque, si décisive pour l’avenir de la Terre, sont abordés : les religions et la naïveté de l’anthropocentrisme ; la nature à la fois inattendue et incontournable du faire-droit qui devrait fonder les normes juridiques ; la question trop vite oubliée du progrès humain, et sa différence avec le « développement » et la « croissance » ; la notion d’Anthropocène et le problème de sa véritable signification philosophique ; enfin, la question du sens comme question philosophique la plus fondamentale et la plus difficile. Le Grand Décentrement provoqué par Ego Alter révèle alors qu’à l’heure de l’alliance objective entre l’obscurantisme créationniste et le relativisme « post-vérité », à l’heure aussi du fantasme transhumaniste d’immortalité et des paranoïaques « théories du complot », c’est notre recul sur nous-mêmes qui est en crise. Or, cette réflexivité possède en réalité trois formes, et c’est pourquoi la crise bien connue des idéologies politico-économiques s’accompagne des deux crises de l’exemplarité et de la synthèse des savoirs, qu’il faut pouvoir surmonter elles aussi pour éviter la catastrophe écologique ultime. À cette fin, il s’agit de comprendre que les trois formes de la réflexivité en crise correspondent aux trois dimensions du sens même de toute chose, qui ne se réduit jamais à la seule dimension de l’ob-jet de connaissance. En définitive, c’est notre finitude que nous devons repenser, par-delà notre puissance écologiquement destructrice, et pour y remédier.
éditions Materiologiques
Date de publication Mars 2021
ISSN 2427-4933
ISBN 978-2-37361-280-6
eISBN 978-2-37361-281-3
EAN13 Papier 9782373612806
EAN13 PDF 9782373612813
Nombre de pages 242
Dimensions 14,8 x 21 cm
Prix livre papier 16 €
Prix ebook pdf 12 €
Société, économie et civilisation
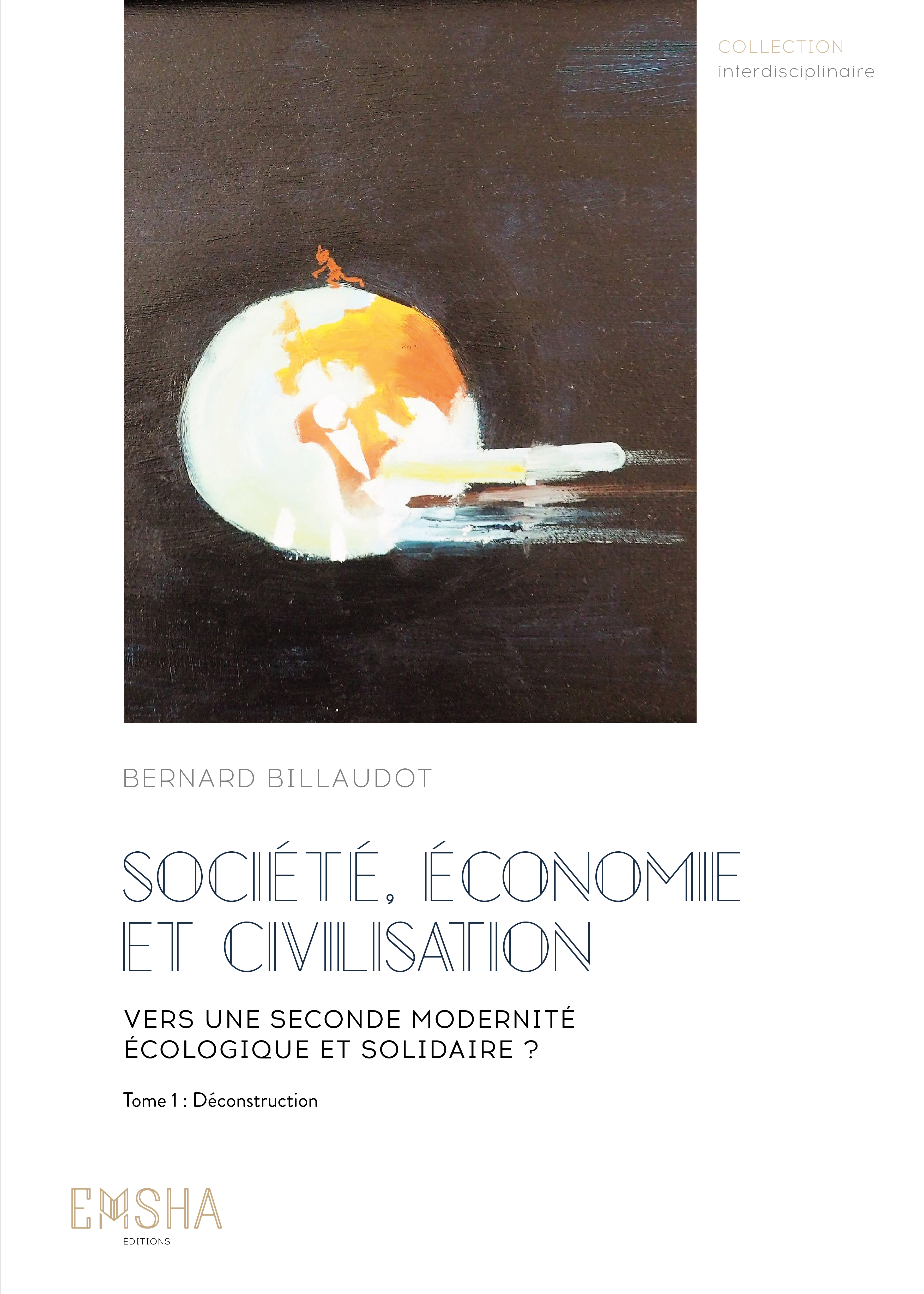 La MSH Paris Nord est heureuse de vous annoncer la sortie d’un nouvel ouvrage aux éditions EMSHA Société, économie et civilisation, Vers une seconde modernité écologique et solidaire ? de Bernard Billaudot.
La MSH Paris Nord est heureuse de vous annoncer la sortie d’un nouvel ouvrage aux éditions EMSHA Société, économie et civilisation, Vers une seconde modernité écologique et solidaire ? de Bernard Billaudot.Explosion des inégalités partout dans le monde, impuissance des États face à la mondialisation économique et montée des nationalismes d’une part, dérèglement climatique d’origine humaine et épuisement des ressources naturelles non reproductibles de l’autre, l’entrée dans le XXIe siècle a tout de la fin d’un monde. Mais qu’est-ce qu’un monde et quel est ce monde qui prend fin ? C’est la question à laquelle ce traité de sciences sociales et humaines se propose de répondre.
Divers mondes se sont succédé dans l’histoire. Celui qui prend fin sous nos yeux n’est pas « le monde moderne », mais seulement celui d’une première modernité. Il repose sur le couplage d’une cosmologie particulière et d’un idéal de justice qui l’est tout autant. La cosmologie est dualiste : elle sépare l’homme de la Nature, alors conçue comme une réserve dont il peut disposer à sa guise. Quant à l’idéal de justice, il se limite à chaque Nation. Il énonce les conditions requises pour que les normes sociales instituées à cette échelle soient considérées comme de « bonnes » normes : elles doivent être favorables à la croissance économique et assurer une répartition équitable de ses fruits entre tous les membres de la population. Si ce monde est présentement en crise, il ne signe pas la fin de l’histoire.
Cet ouvrage présente deux projets dits de seconde modernité : l’un réformiste, l’autre révolutionnaire. Le projet réformiste, qui a notre préférence, conserve une place à chaque Nation. Il imprime une nouvelle orientation à la « construction européenne », susceptible de faire bouger sa frontière géographique actuelle. Ce projet de refondation de la social-démocratie se veut une réponse aux impasses du néolibéralisme de gauche, qui justifie la mondialisation économique sans mondialisation politique. Sa réalisation future ne dépend ni du hasard ni de la nécessité, mais d’une action collective qui devra procéder d’en bas comme d’en haut. Cet ouvrage voudrait y contribuer en forgeant une vision capable de combler le vide né de l’échec du socialisme révolutionnaire et de l’épuisement du socialisme réformiste.
>> consulter le livre sur le site de OpenEdition Books
Éditeur : Éditions des maisons des sciences de l’homme associées
Collection : Collection interdisciplinaire EMSHA
Lieu d’édition : La Plaine-Saint-Denis
Publication sur OpenEdition Books : 02 mars 2021
>> consulter la présentation des éditions des maisons des sciences de l’homme associées EMSHA
