Parution du numéro 11, 2021 de la revue GLAD! Ce numéro thématique de GLAD! consacré aux archives interroge à la fois la production, la conservation…
Catégorie : Publications
Manifeste pour l'écologie humaine
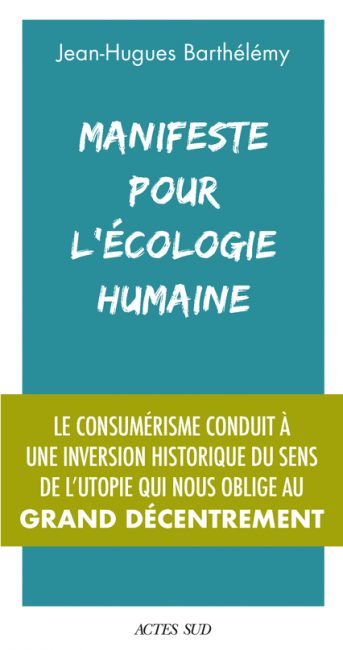
de Jean-Hugues Barthélémy
L’enseignement le plus profond de la catastrophe écologique mondiale en cours est une inversion historique du sens même de l’utopie. À l’origine, ce terme qualifiait les projets sociopolitiques qui ne pourraient trouver de lieu (topos) en ce monde pour se réaliser. Mais aujourd’hui, c’est le monde lui-même, condition de tous les lieux, qui s’apprête à devenir impossible, parce que la transformation du capitalisme en consumérisme surproductiviste a fait de nos sociétés des sociétés du Désir incapables d’intégrer en profondeur un fait pourtant incontournable : l’inexorable destruction de l’équilibre de la biosphère par un mode de vie incompatible avec une Terre dont les ressources sont limitées, et le climat, modifiable. Dans ce contexte, en vertu duquel sont requises en réalité de “nouvelles Lumières”, le programme de l’écologie humaine consiste en un Grand Décentrement permettant de prendre en charge la question que les marxistes n’ont pas voulu penser : celle des fondements du droit lui-même, qui sont à réinventer pour un âge écologique de la pensée et de l’action politiques.
Philosophe, Jean-Hugues Barthélémy est chercheur associé HDR à l’université Paris-Nanterre et membre du Centre d’éthique et de philosophie contemporaine de l’université de Tours. Il est le créateur de la démarche philosophique nouvelle nommée “écologie humaine”, qui vise à unifier l’écologie politique, la philosophie du droit et l’économie politique en les reconstruisant sur la base d’une “écologie du sens” plus fondamentale.
- Actes Sud
- Février 2022
- 10.00 x 19.00 cm
- 144 pages
- ISBN : 978-2-330-16162-0
- Prix indicatif : 11.00€
De(s)liberar el trabajo
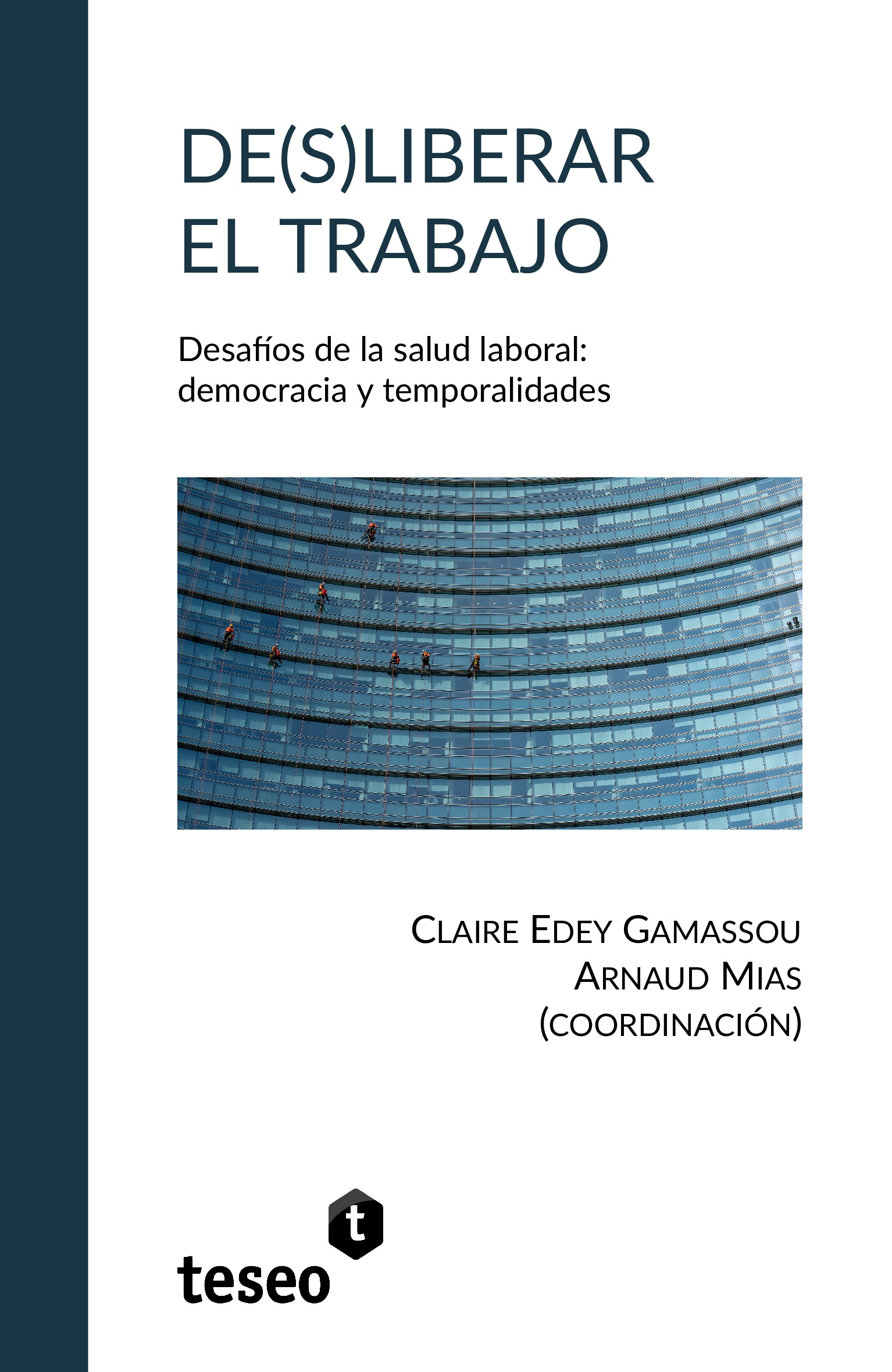
L’ouvrage collectif Dé-libérer le travail : démocratie et temporalité au coeur des enjeux de santé au travail (publié en mars 2021) est traduit en espagnol et disponible en ligne et en téléchargement gratuit sur le site de l’éditeur :
https://www.teseopress.com/desliberareltrabajo
Dé-libérer le travail. Démocratie et temporalités au coeur des enjeux de santé au travail de Claire Edey Gamassou, Arnaud Mias (coordination).
Le temps d’une recomposition profonde des conditions de travail est-il venu ? La crise sanitaire et les mesures qui se succèdent pour y faire face mettent en relief le rôle des frontières sociales, spatiales et temporelles dans l’organisation de l’économie et questionnent le fonctionnement des régimes démocratiques. Ils donnent une visibilité à l’ampleur des inégalités mais aussi à l’importance vitale de certains métiers souvent peu valorisés voire méprisés. Le tableau est sombre mais les expériences de transformation du travail aident à resserrer l’attention sur l’essentiel : une libération réelle du travail, qui nécessite un cadre collectif et la possibilité de délibérer régulièrement, voire d’intervenir dans la gouvernance. Lucide dans le diagnostic du réel, ambitieux dans l’affirmation du désirable : voici le parti-pris de cet ouvrage collectif qui procède de la conviction que la rigueur scientifique peut être mise au service de la transformation du réel, parti-pris qui caractérise l’expérience interdisciplinaire du Groupe d’études sur le travail et la santé au travail (Gestes), Groupement d’Intérêt Scientifique soutenu par le CNRS. Affirmant cette nécessité d’une dé-libération du travail, tout autant que les ambivalences et l’incertitude qui entourent un tel projet de transformation économique et sociale, le présent ouvrage rassemble vingt contributions endossant des perspectives disciplinaires, théoriques et méthodologiques diverses.
La première partie de l’ouvrage aborde la question des effets des nouvelles formes d’organisation temporelle du travail, notamment pour les femmes. La deuxième partie de l’ouvrage, tout en explorant le contenu du travail, met en évidence les liens entre conditions d’emploi et conditions de travail, notamment en faisant apparaître la façon dont le statut d’emploi affecte la frontière entre travail et hors-travail. La troisième partie porte sur des formes « alternatives » d’organisation du travail réputées plus ouvertes à l’expression des salariés et questionne leur portée. La quatrième partie de l’ouvrage déplace le regard vers les dispositifs, managériaux ou légaux, qui sont censés favoriser la délibération sur le travail.
Cet ouvrage fait suite au colloque interdisciplinaire et international qui s’est tenu à la MSH Paris Nord les 21 et 22 novembre 2019
>> consulter la présentation du colloque
https://www.mshparisnord.fr/event/colloque-international-et-interdisciplinaire-de-liberer-le-travail/
- Éditeur : Teseo Press
- Auteurs : Claire Edey Gamassou et Arnaud Mias (coordination)
>> consulter le livre en français sur le site de l’éditeur
https://www.teseopress.com/delibererletravail/
